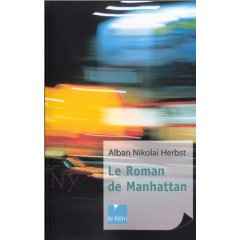À gauche et à droite, des barbelés, et par-delà, ce n’étaient que champs encombrés de déchets. Des bâtiments administratifs, vidés, ouverts, des usines oubliées. Parfois s’élevait encore une cheminée issue des profondeurs. Au-dessus de la peinture craquelée des murs, des graffitis colorés de larges bandes pop. Rien que des blocs de pierre désormais et des voies vides menant vers des tunnels bas. Au-dessus des entrées qui signalaient les souterrains se balançaient des lampes tempête. Certaines étaient reliées au réseau et lançaient des lueurs ou plutôt leurs éclats blafards projetaient des ombres imaginaires. Des bouches de métro et des couloirs d’égouts se coulaient au milieu d’étranges blocs de granit comme si on les avait dégagées à coups d’explosif. C’était des sortes de portes ou de porches. À l’entrée de l’un d’eux je suivis des yeux un sans-abri. Ils l’appelaient Sky. Il était assis entre des rocs éclatés et fixait le fleuve en contrebas. Ses pupilles s’élevèrent un instant. Peut-être un souvenir. Incapable de pleurer. Mais son nez coulait.
Il se passa la manche sur le visage.
La scène disparut. À gauche et à droite des digues, des retenues. Penché légèrement vers l’avant, la tête enfoncée dans le cou, je voyais se dessiner des fondations sur lesquelles se dressaient déjà des constructions de briques. Indifférent, le chemin de fer ne cessait de tailler ses découpes, cicatrices soigneusement vissées par les services d’urbanisme, par des architectes, des paysagistes, mais qui reliaient d’une certaine manière la cime claire et fièrement tendue de la ville aux sombres ensembles de la terre. Vue des trains, la ville ne pouvait laisser longtemps dans l’ombre l’essentiel de ses atours.
Le train pénétra bientôt dans la nuit souterraine. Quelques minutes encore et il s’arrêta sous le Madison Square Garden à Penn Station, au centre de Manhattan. Sur le quai se tenait un jeune employé qui ressemblait à Jim Knopf. J’eus un sourire pour cette apparition venue de mes années d’enfance, mais il aurait été bien en peine de deviner pourquoi j’étais si heureux de le croiser. Ce qui ne l’empêcha pas de répondre à mon sourire. La honte. Cet employé avait sans doute voulu me consoler. Ou se consoler. Et se souvenir du bon vieux temps : la gare avait été construite sur le modèle des thermes de Caracalla et on l’avait ornée à l’époque d’une arcade dont les plaques de marbre étaient du même rose que ses montants de granit. Au-dessus du gigantesque hall principal, on avait tendu une structure vitrée. De nos jours, le voyageur montant des quais souterrains débouchait sur une esplanade fonctionnelle : à une extrémité de l’immense espace couvert, l’AMTRAK avait installé ses guichets et ses services. Vaste enclos en forme de salle d’attente, tout de suite à droite du mur. Pour y accéder, on devait montrer son billet. Tout le long des boutiques de hamburgers journaux cravates. On pouvait acheter de la glace, des sodas et du popcorn : il flottait une douce odeur de caramel. Les gens étaient assis par terre ou s’entassaient debout, les yeux rivés sur des écrans suspendus au plafond pour suivre les arrivées et les départs. De la musique classique ruisselait sur les valises et les sacs à dos, glissait sur ceux que l’on voyait bâillant, en attente, s’étirant. Quelqu’un balayait. Une voiture de nettoyage vint se frotter tout près puis s’éloigna. De temps en temps s’élançaient les voix amidonnées des annonceurs. Dans un couloir attenant à un cordonnier : le long du mur douze ou treize chaises de cireurs sur lesquelles trônaient des espèces de courtiers qui se faisaient reluire le cuir Alden par leurs esclaves. Plus loin un autre couloir avec des recoins pour consommer ou communiquer : il menait aux stations de métro ; c’est là que la LIRR avait ses bureaux : la Long Island Railroad conduisait directement jusqu’au Montauk de Max Frisch. L’endroit idéal pour lire : « En Amérique ». 
Ascension d’escalator. 7th Avenue Penn Plaza Drive. “Arrêtez!” Un jeune noir détala, bouscula les gens, talonné par quelques policiers. Crissements de pneus, sirènes à l’approche, klaxons, cris. Le fuyard courait en zigzag. Il s’arrêta, tomba quasiment dans les bras du cop le plus proche. Sa course fut gelée sur place : paralysé. Il n’esquiva même pas quand le cop lui tira dessus. Il se retourna simplement, lentement, comme s’il pivotait sur les talons, porta sans brusquerie sa main à l’intérieur de son blouson. Son dernier regard, stupéfait, se posa sur les choses du monde. C’était une sorte de caresse destinée aux rues, aux autos, aux passants ; elle m’effleura aussi. Le temps s’arrêta, puis explosa dans le fracas des revolvers. Éclatement du temps, comme si son regard l’avait comprimé trop fortement : les quarante et une balles précipitèrent Momodou Dembang sur le sol. Toujours les hurlements des sirènes. Toujours les klaxons. Cris épars. Une ambulance emporta le corps.
Arrivé. À Manhattan.
Talisker n’était pas fatigué. New York City avait six heures de retard par rapport à l’heure allemande, mais dans la file tassée à l’entrée des guichets de l’immigration il ressentait seulement un léger vertige. Rubans de plastique noirs tendus pour matérialiser les files d’attente. Talisker tendit son visa d’entrée et regarda le fonctionnaire droit dans les yeux avec ironie, simplement pour donner un peu de chaleur au timelag. Talisker n’avait jamais été du genre moqueur. Mais le sérieux des autorités lui apparaissait grotesque. Il essayait en même temps de décrypter des signes furtifs derrière les gestes. Brutalement le fonctionnaire lui signifia qu’il pouvait passer. En Allemagne, Talisker n’avait-il pas déjà remarqué que son billet avait été scanné par un petit appareil à main discrètement caché ? Il savait bien que c’était une procédure habituelle. Il est vrai tout à fait adaptée au rêve. Restait la question : comment les employés de l’aéroport étaient-ils au courant ? Il valait mieux ne rien laisser paraître. D’autant qu’il avait été rassuré de se voir dès le contrôle de British Airways considéré comme normal. C’est donc qu’il n’était pas fou.
Je ne l’étais pas non plus. Talisker en aurait encore environ pour une demi-heure. J’étais certain qu’il prendrait le bus express à 10 $ et non le bus de ville qui ne coûtait que 3,25 $, mais qui devait traverser en cahotant la moitié de Jersey City pour rejoindre Manhattan. Il n’était pas question pour Talisker de prendre un taxi, bien qu’une chaleur inhabituelle l’ait accueilli. New York City était à la même latitude que Naples, mais il n’y avait pas songé. L’idée lui fut agréable. Il avait décollé à douze heures pour arriver à dix-sept heures ; sans l’escale de Londres-Heathrow, pensa-t-il, aucun temps ne se serait écoulé.
Immédiatement à droite en sortant, le terminal des bus au toit plat. De nombreux couloirs. Peu de gens pourtant. Impatience soudaine. Mais le bus express prenait à l’instant le virage menant au terminal. Talisker se procura un billet auprès d’une grosse Noire autoritaire en uniforme bleu qui allait et venait devant le véhicule. Mais quelle énorme paire de fesses ! Avec rudesse elle saisit son billet de banque. À se demander ce qu’est devenue l’amabilité: rien que de l’aigreur et du sérieux ! Seuls deux Noirs eurent un rire éclatant en passant devant le Blanc venu de l’étranger. C’est en leur compagnie et celle de six ou sept autres voyageurs que Talisker monta. Le bus démarra en pétaradant. Dans un contre-jour éblouissant, des ponts noirs de nuit. On longea des complexes interminables. Industrie. Bâtiments écrasés au milieu d’un entrelacs de rues jonchées de déchets. Deux rangées devant lui, Talisker voyait s’agiter les longs doigts magnifiques des Noirs qu’ils tortillaient étrangement pour compléter leurs phrases. C’était une suite de figures qui se renouvelaient sans cesse. Leurs paumes blanches croisaient et décroisaient leurs phalanges, et ce frottement permanent semblait produire sur la peau une énergie lumineuse. Talisker essaya vainement de découvrir le sens de cette langue des signes qui prolongeait leur dialogue. Des ponts noirs comme le charbon passèrent devant ses yeux. Énormes courbes grotesques, immenses champs devant, parking dessous, sols couverts de containers. Et voici que la silhouette de la ville émergea du smog. Mais encore des souterrains, des dépôts d’acier, des rocs, des pierres de taille explosées, figées, comme déchiquetées. Reflet de plomb des lacs. On avait l’impression qu’il avait plu à verse. Suites de grilles dans l’ombre, voies étroites et rouillées pour wagonnets : doigts sans fin qui creusaient dans le monde souterrain. C’est ainsi que se présentait l’entrée de New York City Manhattan, même dans le miroitement ombreux de la lumière du soleil.
[>>>>> en Allemand.
>>>> Chapitres 9 – 13
ANH, Le Roman de Manhattan, page de titre <<<<
Alban Nikolai Herbst, In New York, Manhattan Roman.]